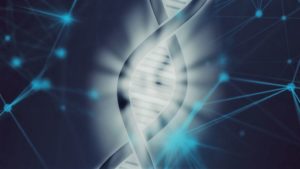« Un cadre dédié et modernisé » pour les nouvelles techniques génomiques
TNC le 06/07/2023 à 14:13
La Commission européenne a adopté le 5 juillet un règlement pour encadrer l’utilisation des nouvelles techniques génomiques (NGT). Le nouveau règlement offre un cadre aux outils et techniques d'édition génétique sans ajout extérieur, et différencie ainsi légalement les NGT des OGM. Les variétés NGT seront bien distinguées en deux catégories.
« L’innovation est indissociable du développement durable : nous voulons donner aux agriculteurs les outils pour produire une alimentation saine et sûre, adaptée aux conditions climatiques changeantes », garantissant « sécurité alimentaire » et compétitivité, a souligné mercredi la commissaire européenne à la santé, Stella Kyriakides.
Variétés plus résistances aux aléas climatiques, au stress hydrique, aux maladies et ravageurs, blé pauvre en gluten… sont autant d’horizons ouverts selon Bruxelles par les « nouvelles techniques génomiques » (NGT), kyrielle d’outils « éditant » le matériel génétique des plantes sans ajout extérieur – contrairement aux organismes génétiquement modifiés (OGM) « transgéniques » introduisant un gène d’une espèce différente.
Pour Bruxelles, ces technologies émergentes pourraient développer des cultures adaptées au climat et plus productives, ou des aliments avec moins d’allergènes. Mais les règles drastiques encadrant les OGM (longue procédure d’autorisation, traçabilité, étiquetage, surveillance…) apparaissent « inadaptées ».
2 catégories de NGT
Le nouveau règlement vise à offrir un cadre juridique modernisé pour les plantes obtenues par mutagénèse et cisgénèse. Ces techniques permettant d’obtenir des produits différents (plus ou moins complexes), la proposition de la Commission européenne distingue deux catégories de NGT :
– Catégorie 1 : elle regrouperait les semences et produits issus de NGT, présentant des modifications susceptibles de se produire naturellement ou via des croisements traditionnels. Sous réserve d’un nombre limité de mutations, ils seraient considérés comme « équivalents » aux variétés conventionnelles et enregistrés dans une base publique, avec l’obligation d’étiquetage spécifique seulement pour les semences. Les variétés résistantes aux herbicides pourraient aussi être concernées.
– Catégorie 2 : celle-ci comporterait toutes les autres variétés NGT, jugées non équivalentes au conventionnel. Ces dernières resteraient alors soumises au régime encadrant les OGM (directive 2001/18). L’obligation de prévoir une méthode de détection pour chaque semence créée pourrait être levée.
À noter aussi : aucun produit NGT ne pourrait être labellisé en agriculture biologique.
« Les prochains mois seront décisifs »
À ce jour, l’UE recense 90 demandes d’autorisation pour des cultures NGT au stade de la recherche, avec seulement quelques tests en plein champ (maïs en Belgique, pommes de terre en Suède…). Des feuilles de moutarde « moins amères » sont déjà commercialisées aux États-Unis et des bananes résistantes au brunissement approuvées aux Philippines. La Commission promet un développement moins onéreux et accéléré (quatre ans au lieu d’une dizaine d’années). La simplification des règles était réclamée par la Copa-Cogeca et une partie des États membres qui entendent négocier de concert la législation NGT avec un autre texte imposant des objectifs de réduction des produits phytos, sur lequel les discussions s’enlisent.
Dans un communiqué, le Collectif en faveur de l’innovation variétale, représentant de nombreux acteurs des filières agricoles et alimentaires*, souligne la nécessité « d’une réglementation équilibrée avec des contraintes proportionnées sous peine d’entraver tout développement de ces technologies pour relever les enjeux alimentaires et agricoles de demain. […] Les prochains mois seront décisifs… ».
« Pour permettre aux acteurs de la filière d’utiliser ces NGT rapidement, cette règlementation devrait être adoptée par le Conseil et le Parlement avant l’échéance électorale européenne de 2024 ou être une priorité de la législature suivante, indiquent également l’Association française des biotechnologies végétales (AFBV) et son partenaire allemand WGG. Sans le respect de cet agenda, la commercialisation de ces plantes NGT dans l’UE sera reportée de plusieurs années et ce, dans un contexte mondial où la commercialisation de certaines variétés NGT a déjà commencé dans plusieurs pays », notent les deux associations.
« Apprentis sorciers »
À l’inverse, plusieurs ONG environnementales et eurodéputés maintiennent leur opposition. Ils réclament que les NGT restent soumis à la réglementation OGM conformément au verdict de 2018 de la Cour de Justice de l’UE. « Il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers, mettre en culture sans évaluation complète et indépendante, sans traçabilité, ni information des consommateurs », insiste l’élu socialiste Christophe Clergeau, soulignant les interactions complexes d’une plante avec son environnement, notamment les pollinisateurs. Pour l’Ifoam (fédération de l’agriculture bio), Bruxelles « sacrifie le principe de précaution » au profit d’« un accélérateur massif du modèle commercial lucratif de l’industrie biotech ». Son inquiétude est de voir le bio déstabilisé par les risques de contamination et les exigences réduites de traçabilité. Pour ses détracteurs, l’édition génomique est loin d’avoir fait ses preuves. « C’est un écran de fumée pour éviter le débat sur la transition agricole durable. Ces « nouveaux OGM » restent un mirage dont on n’est pas certain qu’il se matérialisera », a jugé Mute Schimpf, de Friends of the Earth. L’ONG prône plutôt de « maximiser la diversité » en adaptant localement les variétés.
« La dissémination de nouveaux OGM appauvrira davantage la biodiversité agricole et la santé des sols, essentielle pour garantir la sécurité alimentaire, en encourageant les monocultures et l’uniformité génétique », abonde Francesco Sottile, de Slow Food. La dépendance accrue des cultivateurs aux semenciers, face à la multiplication potentielle des brevets, inquiète également. La Commission promet d’évaluer ultérieurement les questions de propriété intellectuelle. Autre point sensible, l’absence d’étiquetage sur les aliments commercialisés issus de plants NGT : l’association Foodwatch dénonce un « immense recul […] qui priverait les consommateurs de leur droit à savoir ce qui est dans leur assiette ».
*Le collectif regroupe 28 organisations représentatives des agriculteurs et des filières agricoles et agro-alimentaires : AGPB, AGPM, AIBS, Anamso, ANMF, Arvalis, CGB, CTIFL, Fedepom, FN3PT, FNA, Fnams, FNCG, FNPSMS, FNSEA, Fop, Intercéréales, IPTA, JA, la Coopération agricole, Semae, SNFS, Snia, Terres Inovia, Terres Univia, UFS, UNPT et Valhor.