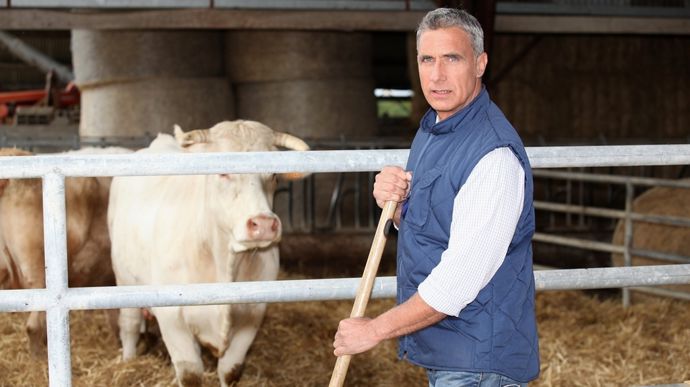Les points de vigilance pour transmettre son élevage bovin
TNC le 24/06/2025 à 05:24
Préférez-vous garder votre maison sur l’exploitation ou la vendre ? Votre troupeau est-il en bon état ? Faut-il poursuivre ou stopper vos investissements ? Êtes-vous propriétaire de vos bâtiments ? Comment transmettre le foncier ? Quelques questions à se poser avant de céder son élevage, et bien en amont !
« Laisser sa ferme et sa maison, une double peine »
Mieux vaut conserver la maison d’habitation ou la vendre au (x) repreneur(s) ? « C’est la première chose sur laquelle les cédants doivent s’interroger, plusieurs années avant leur cessation d’activité agricole et la cession de l’exploitation », estiment d’une même voix les intervenants d’un débat sur la transmission des fermes d’élevage au Salon de l’agriculture de Nouvelle-Aquitaine fin mai. D’autant qu’en productions animales, elle est souvent proche quand elle n’est pas dans le corps de ferme. « C’est le point de départ pour construire le projet de la vie d’après, car cela a de nombreuses répercussions, il faut donc prendre le temps d’y réfléchir. »
Franck Daubin, éleveur à la retraite : Se lever le matin sans passer faire le tour du troupeau, ni entendre le bruit des cornadis, c’est difficile.
« Cette interrogation est lourde de sens et concerne l’exploitant et son/sa conjoint(e). Quitter sa ferme et sa maison familiale, ça peut être la double peine », insiste Fabien Dacharry, conseiller foncier à la Safer Nouvelle-Aquitaine pour le département des Landes. Certains ont envie de continuer à voir leur « bébé », d’autres préfèrent couper complètement. « Mais attention aux contraintes liées à l’activité de l’exploitation (bruit, mouvement de machines et de personnes…). Cohabiter avec le(s) repreneur(s) n’est pas simple non plus », met-il en garde. Ce(s) dernier(s) peuvent aussi vouloir, pour le côté pratique, ne pas être loin des animaux.
« Se lever le matin sans faire un tour du troupeau, ni entendre le bruit des cornadis, etc., c’est difficile, il faut anticiper, s’y préparer témoigne Franck Daubin, éleveur laitier en Gironde à la retraite depuis peu et président du GDS 33. Prendre de la distance ne se fait pas du jour au lendemain. » Pour faciliter cette distanciation affective et pour plus de sérénité, beaucoup d’éleveurs choisissent de s’éloigner et de laisser faire leur(s) sucesseur(s), qui n’ont pas forcément la même vision de la gestion d’un élevage. « Cela n’empêche pas d’aller prendre des nouvelles de temps en temps », fait-il remarquer.
Trouver un repreneur avec les mêmes visions, valeurs…
Deuxième point essentiel : trouver le bon repreneur pour l’exploitation quand le cédant n’a pas de successeur identifié, celui avec lequel il aura le feeling, avec qui il pourra partager un certain nombre de choses et qu’il pourra accompagner de manière plus naturelle durant son installation sur l’élevage. Or, vu le contexte économique et la faible attractivité du secteur, ce n’est pas facile. Là encore, il faut se donner du temps. « De son côté, le repreneur devra lui aussi avoir le feeling pour le cédant, la ferme, ses équipements, le lieu », ajoute Fabien Dacharry.
Il recommande d’en visiter plusieurs et insiste sur l’importance de garder le contact avec le cédant après la cession de la ferme. « Ensuite, il faut travailler les modalités de reprise, en particulier le financement », poursuit le conseiller foncier. Il recommande d’actionner différents leviers : prêts bancaires, foncières… et cela peut demander du temps également. Il invite ensuite à étudier les possibilités de tuilage (parrainage, tutorat) « plutôt que de passer d’un seul coup de « aujourd’hui, c’est moi » à « demain, c’est toi » ». « Psychologiquement parlant, c’est mieux pour le repreneur comme le cédant. »
De plus en plus de normes juridiques, fiscales, sociales
La troisième étape : étudier les aspects juridiques, fiscaux, patrimoniaux, sociaux et leurs impacts. « Il y a de plus en plus de normes », appuie Gaël Gadioux, juriste fiscaliste à la Safer Nouvelle-Aquitaine qui évoque aussi les incidences du développement des énergies renouvelables, le photovoltaïque sur les toitures des hangars entre autres : « Il faut muter les schémas juridiques et auditer les installations. » Selon lui, le recul en la matière est suffisant : « au niveau foncier, il y a des contrats juridiques, les baux emphytéotiques ou à construction, qui facilitent la transmission de l’exploitation et qu’on a l’habitude d’utiliser. »
Avec l’essor des énergies renouvelables, muter les schémas juridiques.
« L’éolien, la méthanisation, l’agrivoltaïsme se développent, mais sur ce dernier on est encore en attente des derniers décrets. Ce sujet est de plus en plus impactant, mais nous n’avons pas encore toutes les réponses. » Par ailleurs, qui dit transmission dit aussi plus-value. « On a, en agricole, des possibilités d’exonération facilement accessibles lorsqu’on choisit de céder à un jeune agriculteur et qui ont été élargies par la loi de finance 2025. Elles sont fonction d’un chiffre d’affaires réalisé sur les deux années antérieures. »
« Céder/reprendre sans état des lieux : achèteriez-vous une voiture sans contrôle technique ? »
Il est également important de réaliser un état des lieux précis de l’élevage, du cheptel en particulier. « On peut avoir l’impression, en regardant le troupeau, que tout est nickel. Mais il peut y avoir un peu, selon les secteurs, de paratuberculose, d’IBR, de BVD, de fièvre aphteuse, de fièvre Q », détaille Franck Daubin. D’où l’importance d’effectuer des analyses pour sécuriser la reprise de la ferme, sinon « c’est comme si vous achetiez une voiture d’occasion sans contrôle technique ». Les techniciens et vétérinaires des GDS sont là pour accompagner les repreneurs et connaissent l’historique des exploitations.
Plus difficile d’estimer les bâtiments que les terres
Crucial bien sûr : le prix de cession de l’élevage. « Pour le prix des terres, il suffit de s’appuyer sur les références locales, la difficulté est plus aujourd’hui sur les bâtiments pour lesquels il y en a peu ou pas », alerte Fabien Lacharry. « Quelle décote appliquer ? », interroge-t-il avant d’ajouter : « Attention : si l’on est trop gourmand, on ne trouvera pas de repreneur. » Gaël Gadioux parle, lui, de bâti « dormant » que les banques sont plus réticentes à financer.
Ici aussi il y a tout un travail psychologique à faire avec le cédant. Fabien Lacharry confirme : « Céder le travail d’une vie, notamment sur la génétique, c’est une charge émotionnelle mais aussi mentale très forte. Il faut prendre le temps de digérer la partie technique mais aussi psychologique. » Il explique qu’il y a trois « bon prix » – que l’on se place du côté du cédant, du repreneur ou du marché – totalement décorrélés, la difficulté étant de faire accepter cette décorrélation.
Continuer d’investir en génétique, moins en équipements
Quid de la reprenabilité des fermes d’élevage et des capitaux nécessaires au vu de leur agrandissement significatif ces dernières années ? Alors faut-il poursuivre les investissements jusqu’au bout pour préserver la performance de l’exploitation et espérer en tirer le meilleur prix, même s’il sera compliqué de trouver un repreneur ou, au contraire, arrêter d’investir ?
Franck Daubin, qui est passé par là, penche pour la première solution. « Il faut continuer de travailler la génétique, pour que la structure soit toujours performante et productive et que le repreneur puisse dégager un bon revenu. » Pour le reste, il considère qu’il faut lever un peu le pied quatre-cinq ans avant la retraite car le repreneur n’aura pas forcément le même regard sur le matériel, l’organisation et l’agencement des bâtiments…
« Ne risque-t-on pas d’handicaper le repreneur en lui transmettant un outil de travail qu’il va payer cher et/ou qu’il devra encore rembourser, avec des équipements qui ne lui seront peut-être pas utiles ? », questionne-t-il. Gaël partage son avis : « Trop se spécialiser peut complexifier la recherche d’un successeur. » « Pas toujours évident, mais il faut un juste milieu, tranche Franck Daubin. En tout cas, une réflexion s’impose là-dessus, car les répercussions financières peuvent peser fortement. »
Constructions sur sol d’autrui et baux oraux : vigilance…
Fabien Lacharry fait un focus sur les bâtiments : « Certes, nous les évaluons un par un. Ensemble néanmoins, ils créent un effet « bloc ». La discussion porte alors sur le pourcentage de baisse que les cédants sont prêts à consentir par rapport à la valeur réelle. » Gaël Gadioux attire, lui, l’attention sur un problème fréquent : la construction sur sol d’autrui, autrement dit sur des parcelles n’appartenant pas aux éleveurs, mais à la société d’exploitation, aux parents, pire à un propriétaire tiers. « Au moment de la cession, il va falloir réunir ces bâtiments et le terrain où ils sont localisés. »
Pour limiter le montant de la reprise, une solution peut être de vendre les bâtiments et louer les terres ou les mettre à disposition via une convention de mise à disposition avec la Safer. L’organisme propose des dispositifs de portage ou stockage du foncier. Et il est possible de recourir aux foncières.
« Depuis quelques années, les terres se transmettent de plus en plus via des cessions de parts de société plutôt que par des transactions directes », constate le juriste fiscaliste. Ce qui impose une préparation juridique et fiscale d’au moins 12 à 18 mois, car des outils permettent d’avoir « une transmission sans fiscalité ou presque, ou du moins adoucie. »
Il observe, en outre, la prédominance en élevage des Gaec, une forme juridique avec des spécificités telle que la transparence économique et fiscale. La question est de savoir si le ou les associé(s) partiront en même temps, et sinon sous quel statut ils resteront. Vigilance de mise encore sur les baux. Il peut y en avoir beaucoup à réunir, sachant qu’ils sont encore fréquemment conclus oralement. Pour sécuriser les transferts, il faut donc rencontrer tous les propriétaires. « Car il y a de la Pac dessus, des droits à produire ! », lance le conseiller juridique et fiscal.
Franck Daubin conclut sur une note d’optimisme : « les perspectives en élevage bovin sont plutôt encourageantes en termes de prix, qui sont remontés en lait comme en viande, de consommation qui se maintient et d’export, nos voisins n’ayant pas tous comme nous des cheptels allaitants naisseurs, souches. Il faut manger moins de viande mais mieux, et l’élevage français, de qualité, est bien placé pour répondre à cet enjeu. »